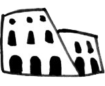A l’époque romaine
la peine de mort était parfois aggravée par la damnatio ad bestias, c’est-à-dire être dévorés par les animaux sauvages.
Le condamné était généralement lié à un poteau et poussé vers les bêtes, comme on le voit dans l’image ci-dessous (une autre punition consistait à utiliser de petits carnivores pour prolonger leur souffrance).

Dans le roman Satyricon de Pétrone, Échion, un personnage qui négocie en haillons, parle du prochain spectacle de l’arène, où un esclave/trésorier (nous dirions aujourd’hui peut-être un comptable) doit ainsi rencontrer la mort :
« N’allons-nous pas avoir dans trois jours une munus magnifique, un combat où figureront non seulement des gladiateurs, mais un grand nombre d’affranchis. Titus, mon maître, est un homme aux vues larges, qui a le cerveau toujours en ébullition : il y aura quelque chose d’extraordinaire d’une manière ou de l’autre.
Je le connais bien, étant de la maison. Il ne fait pas les choses à moitié. Il donnera aux combattants le fer le meilleur ; il leur refusera le droit de fuir.
Nous sommes donc sûrs d’assister à un magnifique carnage. Et il a de quoi se payer ça. Il a hérité de trente millions de sesterces à la mort de son père.

Quand bien mémé il en gaspillerait quatre cent mille, sa fortune n’en souffrira pas, et il y gagnera une gloire impérissable. Il a déjà pour ce spectacle quelques petits chevaux gaulois avec une conductrice de char à la gauloise, et surtout l’intendant de Glycon, qui s’est fait pincer pendant qu’il était en train de combler d’aise sa maîtresse.
Les uns prennent parti pour le mari jaloux, les autres pour l’amant : il y aura de quoi rire. En attendant, Glycon, ce vieux grigou, jette son intendant aux bêtes.
C’est se donner en spectacle de gaîté de coeur. En quoi l’esclave est-il coupable ? Il lui fallait bien obéir à sa maîtresse.
C’est plutôt ce sac à foutre qu’il fallait jeter au taureau. Mais quand on ne peut frapper l’âne on se venge sur le bât.
Du reste, Glycon aurait dû se douter que la fille d’Hermogène ne ferait pas une bonne fin. Autant vouloir couper les ongles à un milan en plein essor. Une couleuvre n’engendre par une corde.
Glycon a tendu la joue : le voilà marqué pour la vie d’une tache que seule la mort effacera : à chacun de porter les conséquences de ses actes. Mais je subodore déjà le festin que Mammea va nous donner : il y aura bien deux deniers d’or pour moi et les miens.
S’il fait cela, puisse-t-il supplanter complètement Norbanus dans la faveur publique et voguer à pleines voiles vers la fortune. Et, en définitive, qu’est-ce que l’autre a fait de bon ? Il nous a exhibé des gladiateurs de quatre sous, déjà si décrépits qu’un souffle les eût fait tomber.
Ils n’étaient pas même bons pour être exposés aux bêtes. Il y avait des cavaliers combattant aux flambeaux : ils avaient l’air de vraies poules mouillées. L’un engourdi, l’autre cagneux, le troisième, qui le remplaça quand il tomba mort, un cadavre sur un cadavre : ses nerfs coupés !
Seul un Thrace fut à peu près potable ; encore, insuffisamment entraîné, semblait-il répéter une leçon apprise. A la fin on les a tous passés aux étrivières, tant le public, qui était nombreux, avait dû crier de fois : « Allez-y ! Poussez-les ! » Bref, une vraie déroute.
A la sortie, Norbanus me dit : Hein, je vous en ai donné, des jeux ! – Et moi, répondis-je, je vous en ai donné des applaudissements ! Comptons sérieusement : j’ai plus donné que reçu. Une main lave l’autre, dit le proverbe. »