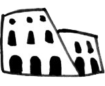Néron, (Lucius Domitius Claudius Nero – Antium 37 après J.-C.-Rome 68, empereur romain (54-68).
Fils d’un patricien, Cneius Domitius Ahenobarbus, il était le neveu de Caligula et le descendant d’Auguste par sa mère, Agrippine la Jeune. Mariée à l’empereur Claude, celle-ci lui fait adopter Néron (en 50), qui épouse Octavie, fille de Claude, en 53.
Après avoir empoisonné l’empereur, Agrippine fait reconnaître le pouvoir de Néron (54). Il est alors entouré par deux hommes de talent, Burrus et Sénèque. Les cinq premières années sont heureuses et modérées. Mais la tutelle de sa mère devient trop pesante. Néron, qui a déjà fait empoisonner en 55 le fils de Claude, Britannicus, fait périr Agrippine en 59.

À partir de ce moment, il gouverne en tyran, s’appuyant sur le préfet du prétoire Tigellin, qui a succédé à Burrus (62). Il épouse Poppée après avoir répudié Octavie. Son impopularité grandit rapidement et des conjurations (comme celle de C. Calpurnius Pison en 65) sont réprimées en utilisant la loi de majesté : Sénèque doit se suicider.
Le règne s’achève dans une atmosphère de terreur. Dans le même temps, l’esthétisme de Néron l’entraîne à participer à des concours lors des grands jeux, à déclamer ses propres poèmes. Il profite du grand incendie de Rome en 64, qu’il laisse attribuer aux chrétiens, dont un grand nombre sont exécutés, pour chanter son poème sur la prise de Troie et pour rebâtir le centre de Rome autour de son nouveau palais, la Domus aurea. En 66, il part pour la Grèce, dont il proclame la « liberté » et qu’il exempte du tribut.
À la fin de 67, il revient à Rome. Au début de 68, affronté à la révolte de plusieurs gouverneurs de province (Vindex en Lyonnaise, Galba en Tarraconnaise), abandonné de tous, Néron s’enfuit de Rome. Il se suicide le 9 juin 68.
Sous son règne, la politique extérieure connut cependant quelques succès : il rétablit le protectorat romain sur l’Arménie (59), que lui disputaient les Parthes, et, triomphant des rébellions, il maintint son autorité sur la Bretagne (61), ainsi que sur la Judée (67).
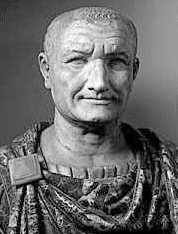
Vespasien (Titus Flavius Vespasianus) (Reate, aujourd’hui Rieti, 9 après J.-C.-Aquae Cutiliae, Sabine, 79)
Fils d’un publicain, il commande une légion en Germanie, puis en Bretagne, où il soumet l’île de Wight. En 66, comme proconsul en Judée, il entreprend de réprimer la révolte des Juifs. Après la mort de Néron (68), il laisse la direction des opérations de Judée à son fils Titus, qui entreprend le siège de Jérusalem. Proclamé empereur en Égypte (69), il se rend maître de Rome, inaugurant ainsi la dynastie flavienne. Il réussit à s’attribuer des pouvoirs plus étendus que ceux d’Auguste, associe Titus au pouvoir dès 71, renouvelle les équipes dirigeantes, sénatoriales et équestres, améliore la discipline militaire et réduit les effectifs de la garde prétorienne. En Gaule, il réprime les révoltes du Batave Civilis et du Lingon Sabinus (70). Il restaure les finances, multiplie les impôts et réalise des économies budgétaires. Il fait construire l’amphithéâtre flavien (Colisée), le temple de la Paix et reconstruire les édifices qui avaient souffert des troubles. Mais il se heurte à une forte opposition du sénat et doit faire face à des conjurations. Son règne a donné les premières années de la « paix romaine ».

Tito (Titus Flavius Sabinus Vespasianus – Rome 39 après J.-C.-Aquae Cutiliae, Sabine, 81)
Fils de Vespasien, il s’empara de Jérusalem (70). Il partagea le pouvoir avec son père et lui succéda en 79. L’opinion lui reprocha sa cruauté ainsi que sa liaison avec la reine Bérénice. En fait, il se montra libéral et renonça à condamner à mort. C’est sous son règne qu’une éruption du Vésuve détruisit Pompéi et Herculanum (79).

Domitien (Caesar Domitianus Augustus, nom d’origine jusqu’à ’81, depuis Titus Flavius Domitianus – 24 Octobre 51 – 18 Septembre 96)
Fils de Vespasien et frère cadet de Titus, il succède à celui-ci. Bon administrateur, il réorganise le Conseil impérial, les bureaux centraux de correspondance et de finances où il fait entrer des chevaliers et contrôle strictement la gestion des provinces. Son action est gênée par des ressources financières insuffisantes alors que se multiplient les jeux publics, les chantiers de construction et les guerres aux frontières. Rome, dévastée par les incendies de 64 et 80, est reconstruite. On élève l’arc de Titus, le temple de la Gens Flavia, l’Odéon et le Stade ; l’amphithéâtre Flavien, ou Colisée, est alors achevé. Les campagnes d’Agricola, au nord de la Bretagne, matent les Calédoniens (82-84). Sur le Danube, contre les Sarmates et les Daces unifiés par Décébale, la guerre dure de 84 à 92. Le succès obtenu, la frontière danubienne, puis, en 89, la région romanisée entre Rhin et Danube (champs Décumates) sont défendues par un nouveau limes fortifié. Le régime impérial devient rapidement absolutiste. L’opposition des sénateurs, victimes de nombreuses condamnations, provoque l’instauration progressive d’un régime de terreur. Après la révolte des légions de Germanie supérieure et l’usurpation de leur chef, Lucius Antonius Saturninus, soutenu à Rome par de nombreux membres de l’aristocratie (88-89), la répression frappe les sénateurs, les philosophes, les juifs et les chrétiens, l’entourage même de l’empereur. Le 18 septembre 96, un complot, dont l’impératrice est complice, met fin aux jours de Domitien, remplacé par Nerva.

Trajan (Marcus Ulpius Traianus (Italica 53-Sélinonte de Cilicie 117)
Légat de Germanie supérieure, il est adopté par Nerva et associé à son pouvoir (97), puis lui succède en 98. Il ménage le sénat et dispose toujours de son appui, développe les institutions alimentaires (alimenta), et engage de grands travaux (forum de Trajan, colonne Trajane, marché, basilique, deux bibliothèques, thermes de l’Esquilin). Mais Trajan est avant tout un soldat, et il mène une politique de conquêtes, les dernières de l’Empire romain : conquête de la Dacie (101-102 et 105-107), dont l’or lui permet de faire face aux dépenses qui l’avaient obligé à vendre une partie du domaine impérial et à abaisser l’aloi de la monnaie ; guerre contre les Parthes (114-116), qui lui permet de créer les provinces d’Arménie, d’Assyrie et de Mésopotamie. Il meurt à son retour d’Orient.

Hadrien (Publius Aelius Hadrianus -Italica 76-Baïes 138)
Empereur de la dynastie des Antonins, Hadrien inaugura une politique de paix et perfectionna l’administration romaine. Il doit sa gloire autant au prestige de son règne qu’aux Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar, qui en fait un souverain conscient de la mission universelle de Rome. L’instaurateur de la « paix romaine »
Descendant d’une famille du Picenum installée en Bétique, Hadrien reçoit une éducation soignée et devient l’un des hommes les plus lettrés de son temps, affichant, toute sa vie, sa prédilection pour la culture grecque. Grâce à la protection de son cousin Trajan, qui est son tuteur, il est successivement sénateur (101), préteur (106), consul (108) et gouverneur de Syrie (117). C’est sur son lit de mort, le 8 août 117, que Trajan adopte Hadrien. Celui-ci lui succède alors à l’âge de 41 ans.
Compagnon d’armes de l’empereur défunt, qui avait été un grand conquérant, Hadrien se veut l’empereur du retour à la paix. Pendant les vingt ans de son règne, il ne mènera aucune expédition. Il préfère renforcer le limes, qu’il ne conçoit pas comme une ligne défensive érigée entre l’Empire et les Barbares, mais comme une zone de contact avec ces derniers, susceptible de servir de point d’appui à une nouvelle offensive.
Réalisé entre 122 et 127, le « mur d’Hadrien » qui sépare l’Angleterre de l’Écosse court sur plus de 120 km. Ayant une vision très large des réalités, Hadrien s’efforce d’intégrer toutes les parties de l’Empire dans un même développement économique et intellectuel, qui doit faire l’unité du monde romain. Dans cette intention, il emploiera les années 121 à 134 à parcourir les provinces (Bretagne, Gaule, Espagne, Afrique, Orient, Dacie), pour mieux connaître les peuples et resserrer leurs liens avec Rome. Il préconise aussi le recrutement des légions dans les régions où elles sont cantonnées.
Malgré son désir de paix, il lui arrivera d’intervenir militairement : ce sera le cas en Judée, pour mater la révolte de Bar-Kokhba (132-135) ; Jérusalem sera transformée en colonie romaine (Aelia Capitolina), où les Juifs seront interdits de séjour. L’administrateur éclairé À Rome, Hadrien mène une politique guidée par le souci de réformer l’administration dans un sens à la fois plus centralisé et plus humain. Il nomme les membres du conseil chargé d’élaborer les Constitutions impériales et place des chevaliers à la tête des bureaux qui doivent les faire appliquer. En 131, il promulgue l’« édit perpétuel », qui codifie les règles de procédure pour en finir avec l’époque où elles variaient au gré des préteurs. Il améliore le sort de la paysannerie et lui donne accès aux baux à long terme pour remédier à l’abandon des terres. Il limite par ailleurs le droit de vie ou de mort des maîtres sur les esclaves. Ce faisant, il s’attire l’hostilité du sénat. Hadrien se consacre aussi à une politique de grands travaux à Rome : il fait construire son mausolée (l’actuel château Saint-Ange), la rotonde du Panthéon, les temples jumeaux du sanctuaire de Vénus et de Rome.
Mais son œuvre la plus personnelle reste sa villa de Tibur (Tivoli), la villa Hadriana, dont les jardins reproduisent les merveilles de l’Empire. C’est dans cette villa que l’empereur, souffrant d’un grave œdème, passe ses dernières années. Pour régler le problème de sa succession, il fixe son choix sur un sénateur sans envergure, Lucius Ceionius Commodus Aelius Verus, qui meurt dès l’année suivante, en 138. Hadrien adopte alors Antonin, son neveu par alliance, qui est aussi un sénateur respecté de tous. En même temps, il l’oblige à adopter lui-même deux enfants, l’un étant le fils de Aelius Verus, qui régnera sous le nom de Lucius Verus (161-169), et l’autre étant Marc Aurèle, un descendant du père de Trajan. Antinoüs pour l’éternité L’une des histoires d’amour les plus poignantes du monde antique fut celle que vécurent l’empereur Hadrien et le jeune Antinoüs, originaire de Bithynie.
Fatal destin ou geste de sacrifice destiné à assurer une longue vie à l’empereur ? Le bel éphèbe, âgé d’à peine 20 ans, se noya dans les eaux boueuses du Nil en l’an 130. Le maître de Rome ne se consola pas de la perte de son favori. Mais on fit de lui tant de statues et on frappa tant de monnaies à son effigie qu’Antinoüs est resté dans l’histoire comme le personnage qui fut le plus représenté. Également divinisé, il eut une ville à son nom (Antinooupolis), sur les lieux mêmes de sa mort, et son culte se répandit dans tout le monde grec, où il se confondit parfois avec ceux d’Apollon ou d’Hermès.
Source : Larousse encyclopedie